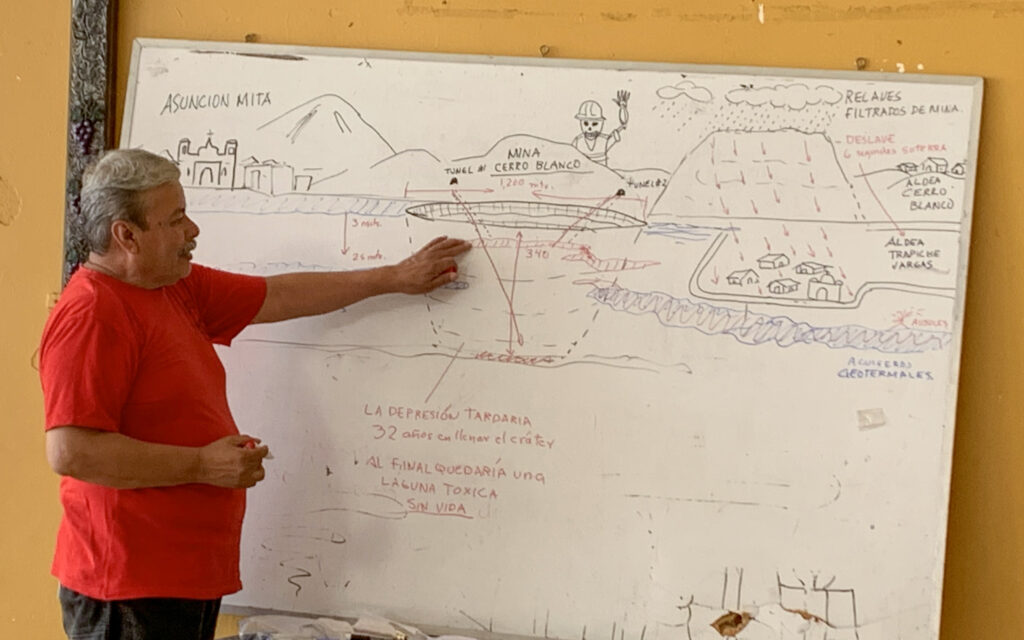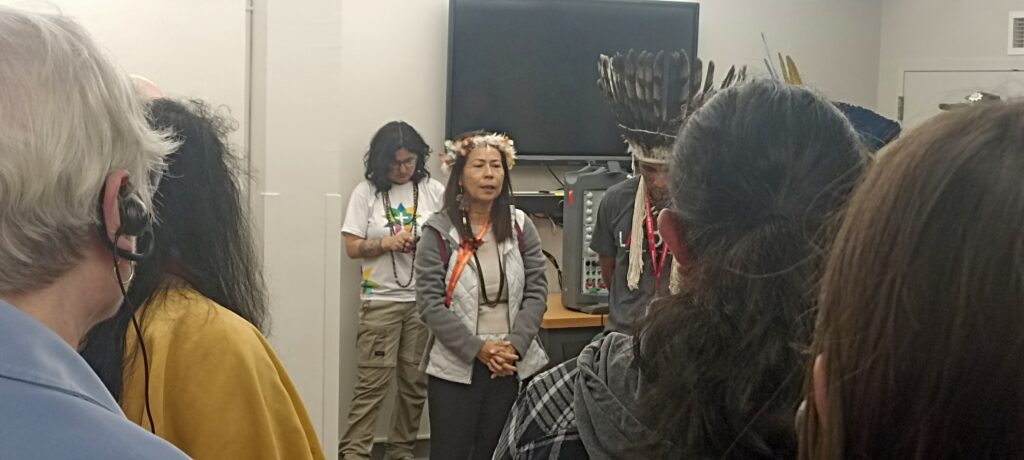Lors du Conseil des droits de l’homme de juin 2024, Franciscans International a invité Mme Ana Victoria López du Réseau franciscain pour les migrants (FNM) au Honduras.
Ce réseau a vu le jour en 2018 suite à l’observation qu’il existait déjà de nombreuses congrégations et communautés franciscaines travaillant de manière indépendante avec les migrants en Amérique latine. Lors d’un cours à Guadalajara, donné par le Bureau de Justice, Paix et Intégrité de la Création de Rome, des frères et des laïcs travaillant avec des migrants ont discuté de la possibilité de créer un « cordon » franciscain, comme on l’a appelé au début.
Depuis lors, ses membres ont non seulement fourni une assistance essentielle sur le terrain, mais ils ont également défendu les droits des migrants en participant à des processus régionaux tels que les négociations de Carthagène +40 et en s’engageant dans le plaidoyer international auprès des Nations unies par l’intermédiaire de FI. Le réseau a été impliqué dans un large éventail de questions, allant des politiques migratoires de plus en plus hostiles à travers les Amériques aux conséquences de plus en plus négatives du changement climatique.
Mme Lopez, qui est chargée de communication pour le réseau et fait partie de son comité de plaidoyer, nous a parlé de quelques-unes de leurs principales priorités et de leurs principaux défis.
Quelles sont les tendances migratoires actuelles que vous observez dans la région ?
Il y a un avant et un après très clair avec l’augmentation des caravanes de migrants qui a commencé en 2017. Avant, il était courant de voir des hommes migrants voyager seuls, mais maintenant, il y a de plus en plus de migrants en transit qui font leur voyage vers les États-Unis en familles ou en grands groupes. Cela est dû en partie aux informations partagées sur les groupes de médias sociaux, où les migrants qui ont réussi à atteindre les États-Unis disent à ceux qui envisagent d’entreprendre le voyage qu’il est plus sûr de voyager en grands groupes. En outre, nous avons commencé à voir de plus en plus de mineurs accompagnés d’un membre de leur famille. Parfois, on remarque qu’il ne s’agit pas d’un membre direct de la famille, en raison de leurs accents différents.
Même si les grands groupes offrent une plus grande protection, les femmes sont toujours très exposées au risque de violence sexuelle. Certaines femmes sont également convaincues de tomber enceintes au cours de leur voyage afin d’augmenter leurs chances d’obtenir un visa ou un statut d’asile une fois arrivées aux États-Unis. Nous les aidons autant que possible, en fournissant des soins et un soutien psychologique à celles qui ont subi des violences sexuelles et des traumatismes. Le réseau aide également les migrants en transit en leur fournissant de la nourriture, des couches ou des serviettes hygiéniques. Souvent, ils n’ont pas d’argent pour acheter ces produits, il est donc important d’être très attentif.
Si les conséquences économiques des migrations liées au climat sont de plus en plus présentes dans les débats internationaux, les pertes et dommages non économiques sont encore souvent négligés. Le constatez-vous chez les migrants avec lesquels vous travaillez ?
Je pense qu’il s’agit d’une question en suspens, car il existe des dommages physiques spécifiques, mais aussi des dommages émotionnels très spécifiques qui n’ont pas de valeur quantitative. Cependant, il est beaucoup plus pratique pour certains gouvernements de dire : « Nous allons leur verser telle somme s’ils retournent dans leur pays », ou “nous allons leur donner le droit à des soins de santé ou à une assurance gratuite”, ou “nous allons leur donner un endroit où vivre”. Mais la réparation des dommages non économiques est rarement mentionnée. Lorsqu’elle l’est, il n’y a pas de suivi. Je pense qu’il est également important de comprendre les conséquences d’une crise sur une personne non seulement comme un traumatisme individuel, mais aussi comme quelque chose de transversal pour les familles et la société. Pourtant, on ne tient pas assez compte du fait que la plupart des personnes qui fuient leur pays ont subi des violences physiques et émotionnelles, des humiliations et des intimidations. Cela a un impact sur leur santé, leurs relations et leur travail. Il faut mieux comprendre ce qui se passe après cet événement traumatisant.
À l’approche des élections aux États-Unis, les politiques migratoires sont au cœur du débat. Quelles conséquences voyez-vous sur le terrain ?
Les politiques américaines ont des répercussions importantes sur les pays d’Amérique centrale, mais c’est surtout la façon dont ces lois sont mises en œuvre qui importe. Aux frontières, c’est la police des frontières qui gouverne. Il y a une distorsion de discours entre ce que dit le gouvernement américain et ce que fait l’immigration américaine. Nous savons qu’en fin de compte, la réalité sur le terrain est très différente.
Par exemple, lorsque les caravanes de migrants sont arrivées aux États-Unis, il a été dit que les pays d’Amérique centrale donneraient du travail à ceux qui rentreraient. Lorsque nous avons vérifié, nous nous sommes rendu compte que l’emploi horaire qui leur était proposé consistait à balayer les rues pendant une ou deux heures. Cela ne leur rapportait même pas le salaire minimum. Ce n’était pas ce qui avait été annoncé politiquement. Et même lorsque cela a été réalisé, ce n’était que pour un petit nombre de personnes.
Il est de notre rôle de combler ce fossé en donnant des informations précises aux migrants afin qu’ils sachent à quoi s’attendre et qu’ils ne croient pas tout ce qu’ils entendent. En fin de compte, je pense qu’il s’agit plutôt de rendre visible la mesure dans laquelle ces lois sur l’immigration sont réellement appliquées.
Qu’est-ce que c’est que d’essayer de changer les politiques internationales ?
Je pense que tout programme issu d’un agenda politique devrait être élaboré en consultation avec les plateformes de la société civile qui s’occupent directement des migrants et des personnes en mobilité. Nous ne sommes pas des fonctionnaires, nous n’appartenons pas à des partis politiques, mais nous voyons la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes les refuges, les soupes populaires, les personnes en première ligne. Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas consultés.
Si les consultations étaient plus inclusives, elles auraient peut-être plus d’impact car nous pourrions fournir des informations importantes. Nous craignons toujours que les diplomates ne fassent des révisions qui ne sont bonnes que sur le papier et que nous ne voyions pas de résultats sur le terrain. Même si les intentions qui sous-tendent ces négociations sont bonnes, tant que l’on ne comprendra pas que la société civile devrait pouvoir contribuer davantage, les changements resteront superficiels.
Pourquoi est-il encore important pour le réseau franciscain pour les migrants de prendre part à ces processus internationaux ?
Au sein du comité de plaidoyer du réseau, chaque équipe nationale doit avoir une certaine connaissance de ce que sont les Nations unies et de la manière de travailler avec ses mécanismes. C’est particulièrement important pour que les contributions soient livrées à temps, car il se passe beaucoup de choses sur le terrain qui doivent être documentées. Nous apprenons également en tant que réseau : si la force du FNM réside dans le fait que nous venons de pays différents, il se peut que certaines réponses ou solutions fonctionnent pour le Panama, mais pas pour nous au Honduras. Venir aux Nations unies à Genève nous permet d’apporter des contributions sur ce que nous vivons et sur les besoins de la base. Il est très important pour nous d’être ici afin de renforcer la convergence entre les équipes.
Pour en savoir plus :
Le travail du FNM : https://franciscansinternational.org/blog/international-migrants-day-preserving-the-dignity-of-people-on-the-move/
Pertes et dommages non économiques : https://franciscansinternational.org/blog/the-unseen-costs-of-climate-change/
Il s’agit d’une traduction automatique. Nous nous excusons pour les erreurs qui auraient pu en résulter. En cas de divergence, la version anglaise fait foi.